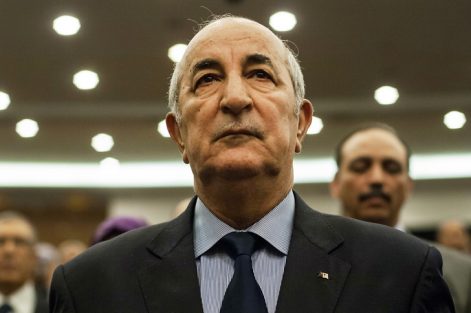L’Algérie est confrontée à une crise économique sans précédent, dont la responsabilité incombe directement à la junte militaire au pouvoir, qui a compromis l’avenir du pays. L’inflation galopante et la dévaluation historique du dinar ne sont que les signes d’une économie en pleine déliquescence, affaiblie par des décennies de mauvaise gestion, de corruption et de répression politique.
Aujourd’hui, la valeur du dinar algérien s’effondre : sur le marché officiel, il se négocie à 0,073 dirham marocain, tandis que sur le marché noir, véritable thermomètre de l’économie, il chute à un niveau abyssal de 0,015 dirham, soit moins de 1,5 centime marocain !
Ce déclin vertigineux contraste avec une époque où, dans les années 1980, un dinar équivalait presque à un dirham. Comment un pays si riche en ressources naturelles a-t-il pu connaître une telle débâcle économique ?
La baisse des prix du pétrole, pilier de l’économie algérienne, ne saurait à elle seule expliquer l’effondrement général. Elle met plutôt en lumière l’échec d’un modèle économique soutenu par les militaires, qui ont pendant des décennies entretenu l’illusion que la rente pétrolière suffirait à maintenir à flot une économie sclérosée. Or, la réalité est bien plus sombre : dépendante à 98 % des hydrocarbures, l’économie algérienne s’effondre dès que les prix du pétrole chutent, et ce, de manière brutale et durable.
Face à ce désastre, les dirigeants militaires se révèlent incapables de mettre en œuvre des réformes économiques substantielles. Ils se rabattent sur des solutions désespérées, telles que la création monétaire, ce qui ne fait qu’aggraver l’inflation et accélérer la dépréciation du dinar.
Cette politique suicidaire, dénoncée par de nombreux experts, ne fait qu’encourager la fuite des capitaux, tandis que les devises étrangères s’envolent. L’euro, notamment, atteint des sommets sur le marché noir (1 euro = 250 dinars), car les Algériens, prévoyant l’effondrement imminent, convertissent leurs économies pour échapper à la dévalorisation de leur monnaie nationale.
La situation est d’autant plus inquiétante que l’Algérie ne parvient plus à attirer les investisseurs étrangers. Qui voudrait risquer son capital dans un pays où la junte militaire piétine l’État de droit et réprime toute opposition ? Le blocage politique constitue un signal d’alarme pour les investisseurs internationaux, qui considèrent désormais l’Algérie comme un terrain miné par l’instabilité et au bord de la faillite.
Pendant que la junte militaire continue de précipiter le pays vers l’abîme, les Algériens, eux, subissent de plein fouet les conséquences de cette gestion calamiteuse. Le pouvoir d’achat s’effondre, la confiance dans le système bancaire disparaît, et de plus en plus de citoyens tentent de protéger leurs économies en acquérant des devises étrangères. Cette fuite en avant ne fera qu’accentuer la dégradation économique du pays.
La faillite de l’Algérie n’est plus une simple hypothèse, elle est déjà en cours. La comparaison avec le Venezuela, autre nation pétrolière en proie à la misère en raison d’une gouvernance autoritaire et corrompue, est aujourd’hui inévitable. L’Algérie s’est engagée dans un cercle vicieux de récession économique, dont il sera extrêmement difficile de sortir. Les coupables de cette situation sont les militaires, qui maintiennent le pays sous leur emprise.
En refusant de reconnaître la réalité et en réprimant toute dissidence, la junte militaire enfonce un peu plus chaque jour l’Algérie dans le chaos. Une chose est certaine : rien ne sera plus jamais comme avant dans ce pays qui, autrefois, disposait de tous les atouts pour réussir, mais qui se dirige désormais droit vers le précipice.