Va-t-on vers une relation toxique entre journalistes et hommes politiques? Ce jeu de pouvoir malsain qui monte en puissance…

La relation entre les journalistes et les hommes politiques a toujours été marquée par une tension inhérente. Ce lien, censé être basé sur la transparence et la responsabilité, se transforme aujourd’hui, au Maroc, trop souvent en un jeu d’influence où les deux parties manipulent les leviers du pouvoir médiatique et politique à leur avantage. Entre corruption, intimidation, et attaques mutuelles, cette dynamique toxique menace à la fois la liberté d’expression de la presse et la démocratie.
Quand les journalistes deviennent des instruments du pouvoir
Pendant cette dernière décennie, on note que certains journalistes, au lieu de jouer leur rôle de contre-pouvoir sain et constructif — instruments de remise en question des politiques publiques — se transforment en relais d’agendas politiques déterminés, achetés par des promesses, des privilèges voire dans certains cas des enveloppes. Ces journalistes fidèles, devenus propagandistes déguisés ou assumés d’entités ou de personnes physiques, privilégient l’éloge au détriment de l’objectivité et de l’analyse non biaisée. Leur crédibilité s’effondre ainsi, celle de leur support et, en général, la confiance du public envers les médias s’ébranle.
Quant à certains hommes politiques, de leur côté, se servent de ces alliances contre nature pour façonner leur image et marginaliser les voix critiques. En achetant la fidélité de certains journalistes, ils étouffent les débats nécessaires et imposent une narration qui leur est favorable sans se soucier de la nocivité de leur actes envers la vie démocratique de la nation.
Les attaques injustifiées : journalistes ou gladiateurs ?
Dans une dynamique inverse, certains journalistes s’arrogent le droit d’attaquer, à tort et à travers, sans fondement. Motivés par des intérêts personnels, idéologiques ou parfois simplement pour gagner en visibilité, — en clics, en vues …— ils construisent des narrations sensationnalistes sans preuves solides. Ce journalisme de confrontation dénature l’essence même de la profession, qui est d’informer et non de détruire gratuitement.
Ces pratiques, loin de renforcer le rôle critique de la presse, affaiblissent la légitimité des journalistes réellement engagés dans des enquêtes fondées et rigoureuses. Ce n’est ni le micro, ni la prose qui font le journalisme, ce sont les enquêtes de terrains, les preuves, les témoignages…
Quand les hommes politiques passent à l’offensive
Les hommes politiques, dans leur élan ne se limitent pas toujours à être des victimes passives. Certains, en effet, n’hésitent pas à user de moyens intimidants pour tenter de museler les journalistes critiques.
C’est ainsi que la porte s’ouvre sur des poursuites abusives. Des procès pour diffamation, assortis de demandes d’indemnisations exorbitantes, deviennent, comme monnaie courante, un outil de dissuasion dont Le but est de décourager toute critique et instaurer un climat de peur tel que dans les rédactions les journalistes sombrent dans l’auto-censure.
L’autre forme de représailles consiste à lancer des campagnes de dénigrement à travers leurs réseaux ou des médias alliés ou affiliés. Des politiciens n’hésitent pas à y orchestrer des attaques personnelles, de toutes sortes, contre des journalistes pour discréditer leur travail.
Sous d’autres cieux, on peut aller plus loin en usant de pressions financières et institutionnelles. Ceci peut prendre plusieurs formes, en coupant les subventions ou en interférant dans la gestion des médias eux mêmes. Le but ultime étant de chercher à asphyxier les médias et journalistes critiques.
Un cercle vicieux autodestructeur
Dans ce jeu malsain dans lequel personne ne sort gagnant, on n’aboutit à qu’à un cercle vicieux et très destructeur pour la nation. Les journalistes fidèles renforcent la propagande politique ; les journalistes agressifs attisent le populisme et la méfiance envers la presse et les institutions enfle. De leur côté, les hommes politiques manipulateurs et offensifs minent la liberté d’expression perdent en crédibilité et estime des électeurs.
Reprendre les bases : vers une relation saine
Seul un chemin inverse peut constituer une sortie de cette impasse. C’est un impératif en trois points qui permettrait un équilibre sain utile pour la continuité de la liberté d’expression, la liberté de la presse et la critique objective utile à la démocratie.
L’état doit renforcer l’indépendance des médias, en Garantissant des financements transparents et indépendants et en protégeant les journalistes contre les pressions politiques et tout en étant intransigeant avec les dérapages non fondés.
L’encouragement de l’éthique journalistique doit passer par la promotion d’un journalisme basé sur des faits et non des intérêts. Un journalisme qui n’attaque pas mais critique de manière objective et constructive. Un journalisme de proposition et non de déballage.
Du côté des politiques, il faudra revenir à la responsabilisation pour limiter les abus de pouvoir et protéger les journalistes d’éventuelles représailles judiciaires ou physiques.
La relation journaliste sphère du pouvoir, bien qu’intrinsèquement tendue, doit se reconstruire sur la base d’une responsabilité mutuelle, construite autour d’un équilibre basé sur le respect des rôles respectifs des uns et des autres. La liberté de la presse, la démocratie ainsi que l’image de toute une nation en dépendent.

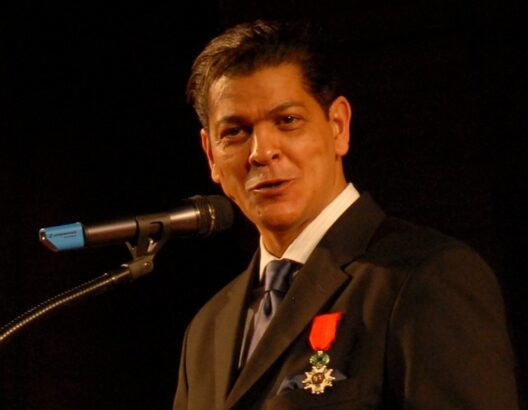


Laisser un commentaire